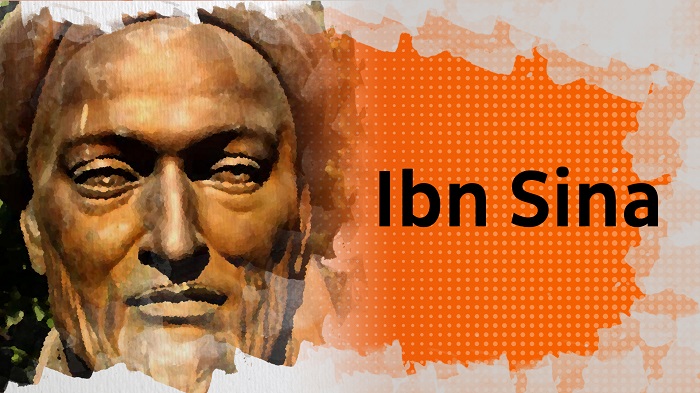Connu sous le nom de «Cheikh el-Raïs» par ses disciples, AbuʾAli al-Husayn Ibn Abd Allah Ibn Sina, plus connu en Occident sous le nom d’Avicenne, s’est imposé comme une figure emblématique de l’Âge d’or islamique.
Né en 980 dans un village près de Boukhara, aujourd’hui en Ouzbékistan, Ibn Sina a débuté ses études dans sa région natale. Passionné par les voyages et la recherche scientifique, il s’est lancé très jeune dans la pratique médicale, offrant ses services dès l’âge de 16 ans. À 30 ans, il avait déjà rédigé de nombreux ouvrages.
Dans son livre «Ibn Sina, vie, parcours et philosophie», Mohamed Kamel al-Hur souligne que «la deuxième phase de la vie de ce savant fut celle de la production scientifique». Ibn Sina a commencé à écrire à 21 ans, ce qui était remarquable pour un jeune homme de cette époque marquée par des conflits politiques et religieux.
Outre la médecine et les sciences naturelles, Ibn Sina s’intéressait également au droit, aux mathématiques, à l’arithmétique, à l’algèbre et à la géométrie. Il a étudié auprès de professeurs renommés, comme Abu Mansur al-Hasan ibn Nuh al-Qumri, médecin à la cour princière, et Abu Sahl Isa ibn Yahya al-Masihi al-Jurjani, auteur d’un traité de médecine.
Doté d’une sensibilité artistique, Ibn Sina s’intéressait aussi à la musique, la littérature et la poésie. En tant que théologien éclairé, il a intégré le dogme dans sa philosophie, affirmant que la métaphysique devait prouver l’existence divine. Il a également commenté l’œuvre d’Aristote en s’appuyant sur les explications d’al-Farabi.
Son ouvrage le plus célèbre, «Le Canon de la médecine», est resté pendant des siècles une référence incontournable pour les praticiens et chercheurs. Mahmoud Abbas Akkad a décrit cet ouvrage comme «un pilier des sciences médicales, basé sur les expériences et traitements d’Ibn Sina». Malheureusement, une partie importante de ce travail a été perdue à cause des raids militaires et des exils forcés.
Un texte fondateur des sciences médicales modernes
Ce qui a été préservé de ce traité encyclopédique, rédigé en arabe et achevé vers 1020, est conservé dans le plus ancien exemplaire connu, daté de 1052. Il a servi de base à l’enseignement des sciences médicales en Europe jusqu’au XVIIe siècle.
Traduit en latin par Gérard de Crémone entre 1150 et 1187 sous le titre «Canon medicinae», puis au début du XVIe siècle par Andrea Alpago, cet ouvrage a été l’un des premiers à être imprimés en arabe, en 1593 à Rome. Ce n’est qu’avec Léonard de Vinci que certaines de ses descriptions anatomiques ont été remises en question.
Ce n’est qu’en 1628, avec la découverte de la circulation sanguine par William Harvey, que certaines théories du «Canon» ont été considérées comme obsolètes.
Ibn Sina a eu le mérite de décrire en détail les premiers symptômes de la méningite et a mis en avant l’importance de la psychothérapie dans le processus de guérison. «Parmi ses exploits, il a diagnostiqué les calculs urinaires avec précision, les différenciant des calculs rénaux, et a décrit les méningites en distinguant leurs variétés», note l’édition 149 du magazine «Daawat Alhaq».
Selon la même source, «il fut parmi les premiers à décrire fidèlement la pleurésie, prouvant qu’elle devait être distinguée de l’abcès du foie, de la pneumonie et des bronchites». Il a également proposé des explications scientifiques plausibles pour la jaunisse, les AVC et la congestion sanguine, et a popularisé l’utilisation du refroidissement pour stopper les saignements.
Des apports scientifiques qui provoquaient l’ire des religieux
En plus de la médecine, Ibn Sina a laissé des ouvrages sur la physique et les sciences naturelles. «Ses œuvres couvrent de nombreuses disciplines, de la poésie à la logique, en passant par la psychologie, la médecine, l’astronomie, les mathématiques, la philosophie, la théologie, l’éthique et la politique», rappelle Mohamed Kamel al-Hur.
Il a écrit plus de 450 livres, dont seulement 240 ont été publiés. Malgré ses contributions majeures à la médecine et à l’anatomie, Ibn Sina a été excommunié pour ses idées. Ibn Qayyim al-Jawziyya a affirmé que la doctrine d’Ibn Sina «était plus proche de l’athéisme que de l’islam», et qu’il avait tenté de réhabiliter des penseurs comme Aristote aux yeux de l’islam.
Le théologien Ibn al-Salah est allé jusqu’à le qualifier de «démon parmi les démons de l’humanité». Cependant, cette stigmatisation n’a pas empêché ses travaux de se diffuser à travers le monde. Raed Amir Abdullah Al-Rashed, qui lui a consacré un livre, souligne l’influence d’Ibn Sina sur les scientifiques occidentaux.
«Le professeur George Sutton affirme qu’il était l’un des plus grands érudits musulmans, célèbre dans le monde entier, et que sa pensée représentait l’idéal philosophique du Moyen Âge», note le chercheur.
Ibn Sina est décédé en 1037 à l’âge de 58 ans et a été enterré à Hamadan, en Iran actuel. Son œuvre a été célébrée par de nombreuses nations pour ses innovations majeures et son développement des sciences médicales. En 1937, les Turcs ont organisé un grand événement pour commémorer les 900 ans de sa mort, suivi par les Arabes et les Perses.